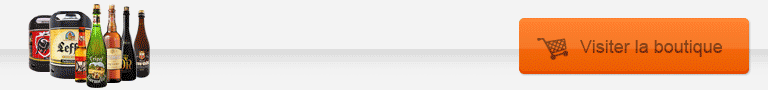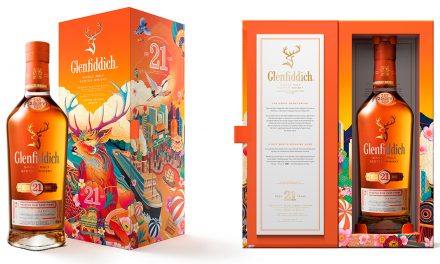Des chercheurs de l’université d’Eindhoven et de l’ETH Zurich ont percé un mystère que les brasseurs tentent de résoudre depuis des siècles : pourquoi certaines bières conservent-elles leur mousse si longtemps ?
En effet qui n’a jamais été frustré de voir la belle mousse crémeuse de sa bière s’effondrer avant même d’avoir pu y tremper les lèvres ? Ce phénomène, familier à tous les amateurs de bière, vient enfin de trouver son explication scientifique grâce à une équipe internationale de chercheurs.
Leur aventure a commencé il y a sept ans de manière plutôt originale. Jan Vermant, professeur à l’ETH Zurich originaire de Belgique, avait posé une question simple à un brasseur belge : « Comment contrôlez-vous le brassage de votre bière ? » La réponse fut lapidaire : « En regardant la mousse. » Cette phrase a lancé une recherche approfondie qui vient d’aboutir à des découvertes surprenantes.
Manolis Chatzigiannakis et Alexandra Alicke, alors doctorants, ont analysé six bières commerciales : quatre bières belges et deux bières suisses. Leur conclusion bouleverse les idées reçues : bien que la stabilité de la mousse puisse être comparable entre différents types de bières, les mécanismes physiques qui l’expliquent sont totalement différents.
Jusqu’à présent, les scientifiques pensaient que la stabilité de la mousse dépendait principalement des protéines présentes à la surface des bulles, provenant du malt d’orge. Ces protéines influencent la viscosité de surface et la tension superficielle. Si cette explication reste valable pour les bières de type lager, elle ne s’applique pas aux bières belges traditionnelles.
Pour les lagers, c’est effectivement la viscoélasticité de surface qui joue le rôle clé : plus la bière contient de protéines, plus la pellicule autour des bulles devient rigide et plus la mousse est stable.
Mais pour les bières de type Tripel belge, le mécanisme est radicalement différent. Ici, la viscoélasticité de surface est quasi inexistante. La stabilité provient des « contraintes de Marangoni », des forces créées par les différences de tension de surface. Ce phénomène peut être observé en plaçant des feuilles de thé à la surface de l’eau : ajoutez une goutte de savon, et les feuilles sont soudainement attirées vers les bords par des courants de surface.
En étudiant la structure microscopique de la mousse, les chercheurs ont découvert que chaque type de bière développe des stratégies différentes. Dans les bières Singel belges, les protéines s’organisent comme de petites particules sphériques densément arrangées à la surface des bulles. Dans les Dubbel, elles forment une structure en réseau, une sorte de membrane qui stabilise encore mieux les bulles.
La protéine LTP1 (lipid transfer protein 1) semble jouer un rôle déterminant dans cette stabilisation, mais les mécanismes exacts restent à élucider.
On notera au passage que cette recherche dépasse largement le cadre de la brasserie. Dans les véhicules électriques, par exemple, la formation de mousse dans les lubrifiants pose de sérieux problèmes : elle réduit leur capacité à évacuer la chaleur des roulements, engrenages et batteries. Les chercheurs collaborent désormais avec de grandes entreprises de lubrifiants pour développer des solutions.
L’équipe travaille également sur des tensioactifs durables sans fluor ni silicium, et explore l’utilisation de mousses comme supports pour des systèmes bactériens. Même la stabilisation de la mousse de lait grâce aux protéines pourrait bénéficier de ces découvertes.
Comme le souligne le professeur Vermant : « La stabilité de la mousse ne dépend pas de facteurs individuels de manière linéaire. On ne peut pas simplement changer ‘quelque chose’ et obtenir le bon résultat. » Augmenter la viscosité avec des tensioactifs supplémentaires peut paradoxalement rendre la mousse plus instable en ralentissant trop les effets de Marangoni.
Cette recherche confirme que le brassage reste un art subtil où l’équilibre des composants joue un rôle crucial. Pour les amateurs de bière belge, cette mousse persistante n’est pas qu’un plaisir visuel : elle influence directement le goût et l’expérience de dégustation. Une belle victoire de la science qui nous aide à mieux comprendre l’un des plaisirs simples de la vie.